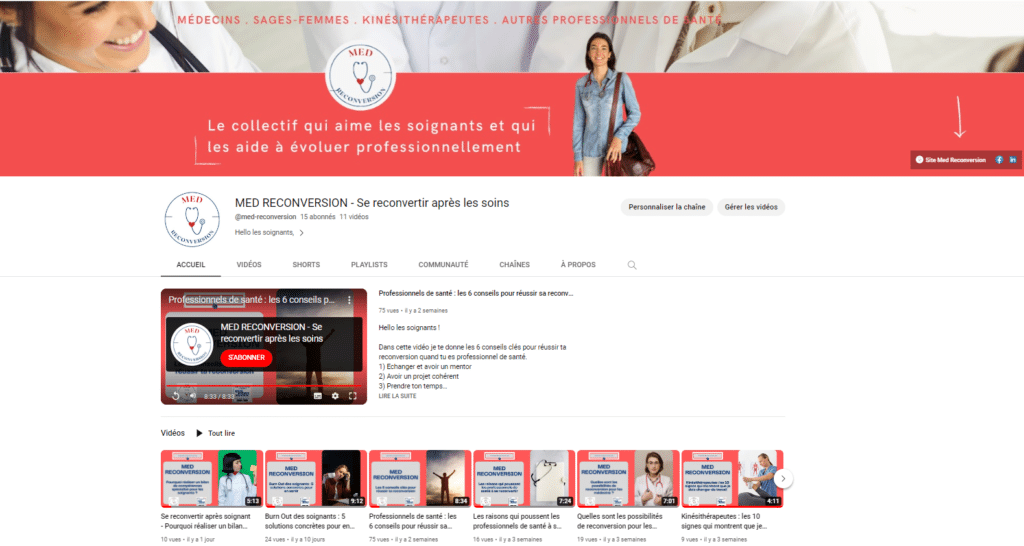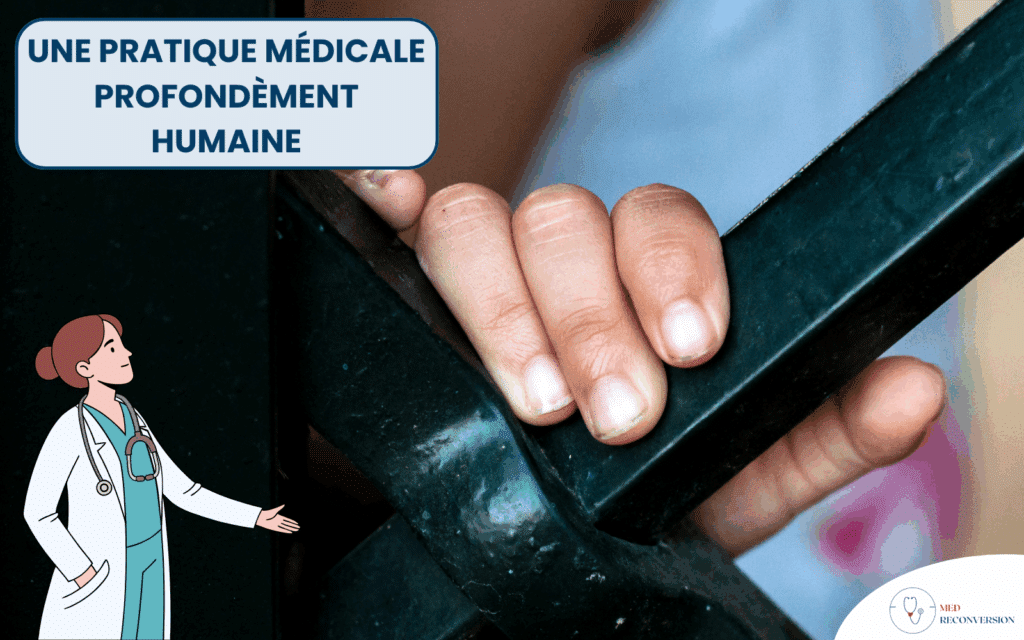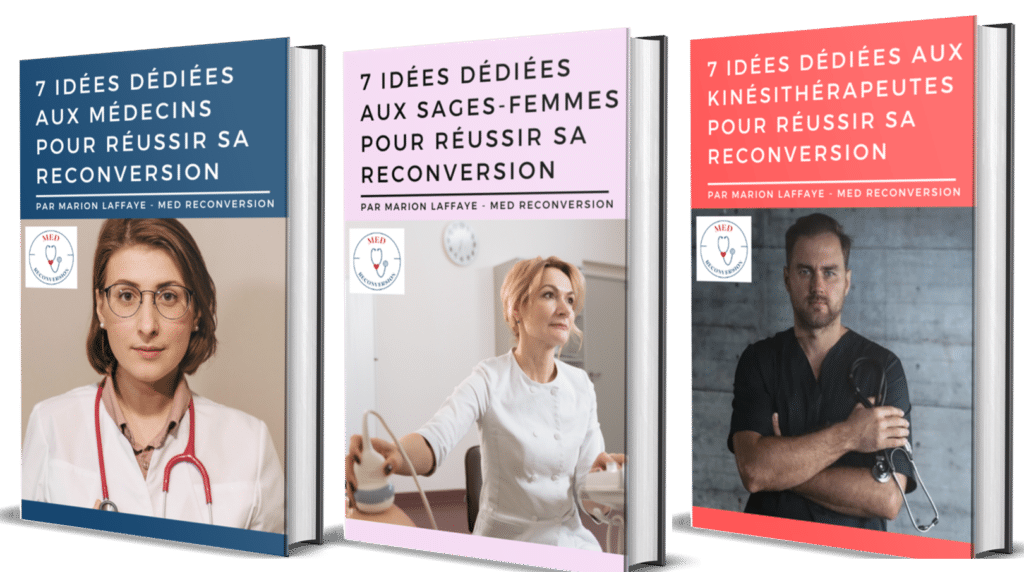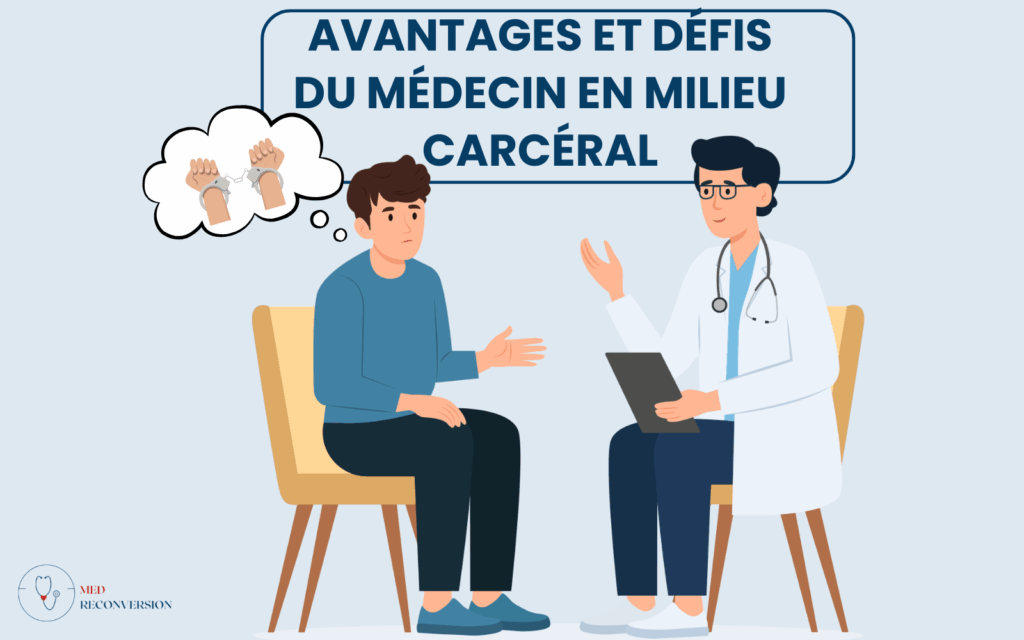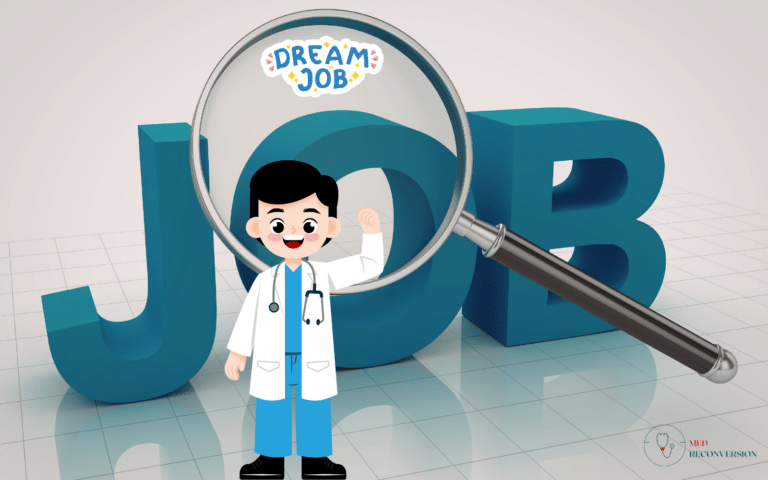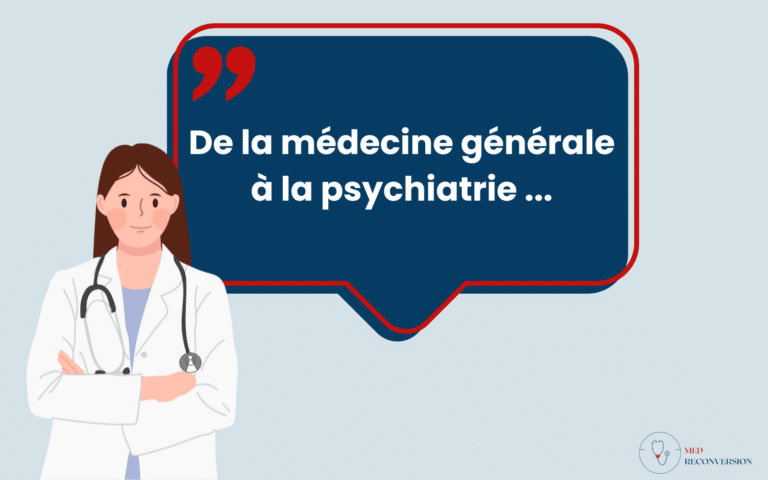Le mot « prison » évoque rarement la santé, la médecine, encore moins la qualité du soin. Pourtant, dans chaque établissement pénitentiaire, une structure médicale existe. Elle fonctionne, soigne, accompagne. Elle s’appelle : unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP).
En tant que médecin en centre pénitentiaire, tu rejoins un service à part, mais reconnu, souvent rattaché à un CHU ou à un centre hospitalier régional. Tu assures le suivi médical de personnes incarcérées, dans un cadre sécurisé, au sein d’une équipe pluridisciplinaire (psychiatrique, dentaire, addictologique…). La médecine y est multiple, ancrée, réelle.
Fanny, médecin généraliste, a choisi de quitter le libéral pour exercer en unité sécurisée. Dans cet article, elle témoigne. Elle parle de ses patients, de ses journées, de ses collègues infirmiers et psychiatres. Et de la place singulière que prend le soin, ici, derrière les murs.
Je suis Marion. Avant d’accompagner les professionnels de santé en évolution, j’étais médecin généraliste. Je sais que parfois, dans ta carrière, tu te poses des questions et tu as besoin d’évoluer. Aujourd’hui, je te présente le témoignage de Fanny, juste pour te montrer que d’autres voies existent.
Avant de continuer, je t’invite à rejoindre les communautés de Med Reconversion sur Instagram et YouTube ! Tu aura ainsi l’occasion de discuter avec d’autres médecins qui se posent des questions super intéressantes sur leur carrière.
Pourquoi Fanny a choisi de devenir médecin en unité carcérale ?
Fanny a commencé comme beaucoup d’autres : une installation en libéral, après quelques remplacements et une phase d’errance post-internat. Elle aimait son métier, mais rapidement, la charge administrative, l’isolement et la pression financière ont commencé à peser. “Je passais plus de temps à coder mes actes et à me justifier qu’à soigner. J’ai tenu deux ans avant de me dire : ce n’est pas ça que je veux faire toute ma vie.”
Un job loin du rêve de jeune médecin
Fanny ne connaissait rien à la médecine en milieu pénitentiaire. Ce n’était ni un projet de longue date, ni un rêve de jeunesse. “Une amie m’a envoyé une annonce pour un poste vacant dans une unité sanitaire. J’ai postulé un peu par curiosité. Une semaine plus tard, j’étais en observation dans un centre de détention. J’ai su tout de suite que ça me parlait.”
Ce qui l’a poussée à sauter le pas ? L’envie de redonner du sens à mon exercice. Le besoin de travailler dans un cadre plus structuré, sans les contraintes du libéral, mais sans renoncer à l’humain. “On soigne des personnes détenues, oui. Mais il y a une population très variée et on reste médecin et on soigne tout ce que les autres médecins soignent : prise en charge médicale du diabète, douleurs, pathologies psychiatriques, bilan de dépistage, suivi de traitement médical, suivi psychologique, … On fait pas mal de prévention.
Ici, les patients ne trichent pas. Ils ne jouent pas les rôles attendus. Les consultations médicales sont aussi l’occasion pour eux de réapprendre à prendre soin de leur corps.”
Médecin en milieu pénitentiaire : mythe VS réalité
Ce n’est pas un métier réservé à ceux qui aiment le défi. “Il faut être stable, clair dans sa posture. Mais il ne faut pas fantasmer une violence permanente. La violence, elle est dans ce que ces personnes ont vécu, parfois dans ce qu’elles ont fait. Mais au quotidien, on reste dans une relation de soin. Ce n’est pas du tout comme dans les séries.”
Une pratique médicale hors norme, mais profondément humaine
Travailler comme médecin en unité carcérale, c’est exercer dans un environnement à part. “La première fois qu’on passe une porte blindée, qu’on entend les verrous, ça marque. On sort de tout ce qu’on connaît en médecine de ville ou à l’hôpital.”
Fanny exerce dans une unité sanitaire, intégrée à l’établissement pénitentiaire mais dépendante du ministère de la Santé.
Le bureau médical est souvent exigu, le matériel limité, mais l’essentiel est là : des soignants, des patients, et une relation de soin à construire dans un cadre très codifié.
“On voit tout type de pathologies, mais aussi des patients qu’aucun système ne prendrait en charge ailleurs. Addictions, troubles psy, pathologies chroniques mal suivies… Beaucoup arrivent en prison dans un état de santé très dégradé.”
Le travail se fait en collaboration avec des infirmiers, des psychologues, parfois un psychiatre, et avec le personnel pénitentiaire pour les questions de sécurité. “C’est un équilibre à trouver. On n’est ni du côté des surveillants, ni du côté des détenus. On est du côté du soin, uniquement.”
Et malgré ce cadre très particulier, Fanny insiste : la relation est souvent plus directe, plus honnête. “Il n’y a pas le filtre social habituel. Beaucoup de détenus ne jouent pas un rôle. Ils viennent, ils parlent, parfois pour la première fois. Et nous, on les écoute, comme on le ferait ailleurs.”
Ce qui la touche ? La reconnaissance. “Même pour un truc simple, un renouvellement de traitement ou une écoute, on te remercie. Il y a une forme de respect du rôle du médecin que j’ai rarement ressentie ailleurs.”
——————–——————–
——————–——————–
Les avantages (et les défis) du métier
Quand on demande à Fanny ce qu’elle apprécie le plus dans son travail en unité carcérale, elle n’hésite pas : “C’est un cadre où je peux exercer sereinement. Il y a un rythme, une équipe, du temps pour les patients… et pour moi.”
Son emploi du temps est stable : pas de gardes, pas d’astreintes, pas de surcharge soudaine. Attention toutefois, c e n’est pas le cas partout. Les consultations sont programmées, les urgences ne sont pas aussi fréquentes qu’on l’imagine.
Autre point fort : le travail en équipe. “On échange avec les infirmiers, les psychologues, l’administration pénitentiaire. C’est très transversal. Il faut apprendre à communiquer clairement, à poser un cadre, mais on ne travaille jamais seul.”
Et puis, il y a le sens. “Je soigne des personnes qui ont souvent été oubliées par le système de santé. J’ai l’impression d’être utile.”
Mais tout n’est pas simple. Le contexte peut peser. L’environnement est fermé, parfois bruyant, toujours sous surveillance. “On s’habitue, mais certains jours, c’est lourd. Il faut accepter de ne pas tout maîtriser, et surtout de ne pas tout régler.”
Il faut aussi poser ses propres limites. “Tu entends des histoires dures. Tu peux être manipulé. Tu dois rester professionnel, clair, neutre. C’est indispensable pour ne pas te laisser submerger.”
« Certains patients demandent des prescriptions de médicaments dont ils espèrent détourner l’usage. Les tentatives de suicide ne sont pas rares. Il y a les petits bobos, le besoin de parler, et les situations plus dramatiques ».
Fanny est claire : ce métier ne conviendra pas à tout le monde. Mais pour ceux qui cherchent un exercice médical différent, ancré dans le réel, c’est une option à considérer sérieusement.
Faut-il une formation spécifique pour exercer en prison ?
Bonne nouvelle : il n’existe pas de spécialité ni de diplôme obligatoire pour devenir médecin en unité carcérale. Fanny le confirme : “Je suis généraliste, sans DU particulier au départ. Ce qui compte, c’est la posture, pas un titre sur un CV.”
En pratique, la majorité des postes sont accessibles aux médecins généralistes, en tant que contractuels ou via la fonction publique hospitalière. Certains postes relèvent directement du secteur hospitalier (UHSI, SMPR), d’autres sont proposés par des structures rattachées à des établissements de santé.
Des formations complémentaires peuvent toutefois être un vrai plus, surtout si tu veux t’ancrer dans cette voie ou évoluer :
- DU santé publique ou médecine légale : pour mieux comprendre les enjeux institutionnels
- DU addictologie ou psychiatrie : très utile vu la prévalence des troubles dans ces contextes
- Formations en éthique, communication ou médiation : pour enrichir ta pratique au quotidien
“Tu apprends surtout sur le terrain. Le plus important, c’est d’avoir envie de comprendre le fonctionnement de l’unité, d’écouter, et de rester à sa place de soignant.”
Pour postuler, il suffit de répondre à une offre (souvent publiée via les hôpitaux de rattachement) ou d’envoyer une candidature spontanée à une unité sanitaire. Il existe aussi des missions ponctuelles ou des remplacements pour tester sans s’engager sur le long terme.
Être médecin en unité carcérale, ce n’est pas choisir la facilité. Ce n’est pas fuir l’hôpital, ni renoncer à la médecine “classique”. C’est faire le choix d’un soin ancré dans le réel, loin du bruit, mais proche de l’essentiel.
Ce métier reste méconnu, parfois mal compris, mais il répond à un vrai besoin. Celui d’apporter des soins à ceux qui, souvent, n’y ont plus accès. Celui d’exercer dans un cadre structuré, avec du temps, de l’équipe, du lien.
Fanny en est convaincue : “On n’imagine pas ce que ce métier peut nous apporter, tant qu’on ne l’a pas expérimenté. Il faut juste ouvrir une porte. Le reste suit.”
Alors si tu ressens cette fatigue de la pratique actuelle, ce décalage entre ton engagement et les conditions d’exercice… peut-être que l’unité carcérale peut être le début d’une autre façon d’être médecin.
Ressources :
- https://www.iledefrance.ars.sante.fr/medecin-en-prison-tout-le-monde-droit-aux-soins
- https://www.chu-brest.fr/notre-offre-de-soin/unite-de-la-maison-darret-usca
A très vite pour de nouvelles inspirations grâce à nos réseaux Med Reconversion !